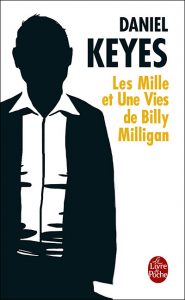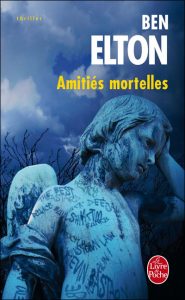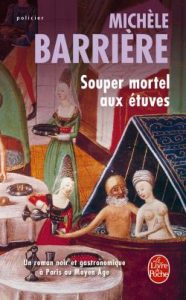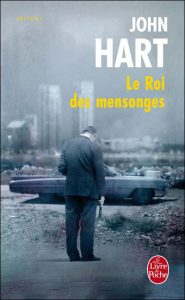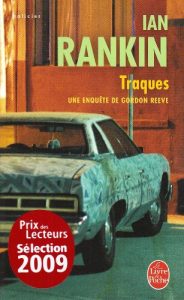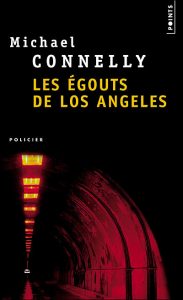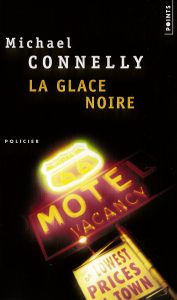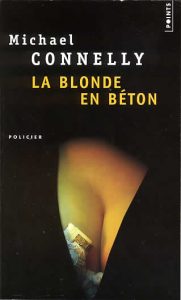Delphine de Vigan, nous offre avec « Les enfants sont rois » un roman qui explore les thèmes de la célébrité, des réseaux sociaux et du besoin de reconnaissance. Publié en 2021, ce livre nous plonge dans un univers où la surexposition médiatique des enfants a des conséquences profondes et souvent inattendues.
Une auteure de talent
Delphine de Vigan est connue pour ses romans introspectifs et émotionnels qui abordent des thèmes complexes avec une grande sensibilité. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve « No et moi » (2007), « Rien ne s’oppose à la nuit » (2011), et « D’après une histoire vraie » (2015). Chacun de ces livres a été salué par la critique et le public, confirmant le talent de l’auteure pour traiter des sujets contemporains avec finesse et profondeur.
« Les enfants sont rois » : un regard critique sur la célébrité des enfants
Dans « Les enfants sont rois », Delphine de Vigan nous raconte l’histoire de Mélanie, une jeune fille devenue célèbre grâce à une vidéo virale. Le roman explore les conséquences de cette soudaine notoriété sur la vie de Mélanie et de sa famille. À travers des personnages bien construits et une narration captivante, l’auteure nous invite à réfléchir sur les dangers de la surexposition médiatique des enfants dans notre société actuelle.
Pourquoi lire « Les enfants sont rois » ?
Le roman aborde des questions sur la célébrité, les réseaux sociaux et l’impact de la médiatisation sur les enfants. C’est une lecture qui incite à la réflexion. Les personnages de Delphine de Vigan sont toujours bien développés. Les lecteurs peuvent s’identifier à eux et comprendre leurs émotions. L’écriture de Delphine de Vigan est poétique. Elle parvient à toucher le cœur de ses lecteurs et à les plonger dans des histoires humaines. De plus, en abordant des thèmes actuels comme les réseaux sociaux et la célébrité, « Les enfants sont rois » est un roman qui parle de notre époque.
Un extrait du livre
Quand sa mère s’adressait à Mélanie, elle commençait généralement ses phrases par « tu », évitant ainsi d’exprimer de manière directe ses propres sentiments, aussitôt suivi d’une négation. Tu ne fais jamais rien, tu ne changeras pas, tu ne m’avais pas prévenue, tu n’as pas vidé le lave-vaisselle, tu ne vas quand même pas sortir comme ça. «Tu» et « ne » étaient indissociables. Lorsque Mélanie avait choisi de commencer une faculté d’anglais, après un bac obtenu sans mention mais du premier coup, sa mère avait dit : « Tu ne penses pas qu’on va payer dix ans d’études ! » Étudier, faire carrière, revenait aux garçons (madame Claux, à son grand regret, n’avait pas eu de fils), tandis que les filles devaient avant tout se préoccuper de trouver un bon mari. Elle-même s’était consacrée à l’éducation de ses enfants et n’avait jamais compris que Mélanie veuille quitter la région, percevant derrière ce choix une forme de snobisme. « Faudrait voir à pas péter plus haut que son cul », avait-elle ajouté, dérogeant exceptionnellement à la règle du « tu ». Malgré cette mise en garde, l’été de ses dix-huit ans, Mélanie avait rempli une valise et s’était installée à Paris. Elle avait d’abord habité une chambre de bonne avec toilettes et lavabo sur le palier dans le VII arrondissement, en échange de quatre soirées par semaine de baby-sitting, puis avait loué un minuscule studio dans le XV (elle avait trouvé un job dans une agence de voyages et son père lui envoyait deux cents euros par mois).
« Les enfants sont rois » de Delphine de Vigan
Comment elle en était venue à quitter l’univer sité pour travailler à plein temps pour l’agence, elle n’aurait pas su l’expliquer, si ce n’est que tout lui semblait parfois écrit d’avance, les succès comme les échecs, et qu’aucun signe ne lui avait été adressé l’encourageant à poursuivre ses études: ses résul- tats étaient corrects, mais d’autres étudiants par- laient déjà sans aucun accent et écrivaient un anglais parfait. Surtout, lorsqu’à partir du present continuous elle tentait de se projeter dans le futur, elle ne voyait rien. Rien du tout. Lorsqu’il s’était libéré, la directrice de l’agence lui avait proposé ce poste d’assistante, qui mêlait des aspects à la fois humains et administratifs, et elle avait dit oui. Les journées passaient vite et elle se sentait à sa place. Le soir, elle rentrait dans le petit studio de la rue Violet, qu’elle finançait seule désormais, se prépa- rait un plateau-repas et ne ratait aucun programme de téléréalité. L’Île de la tentation, bien qu’un peu trop immoral à son goût, et le Bachelor, plus roman- tique, étaient de loin ses préférés. Le week-end, elle sortait avec son amie Jess (rencontrée au collège et elle aussi montée à Paris) pour boire des bières dans un bar ou de la vodka orange en boîte de nuit.