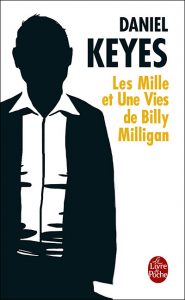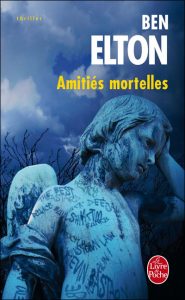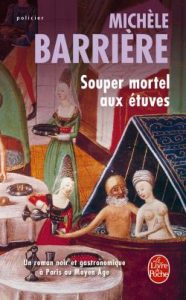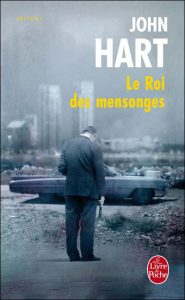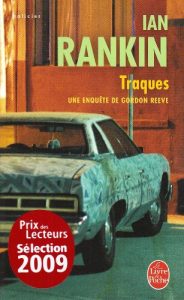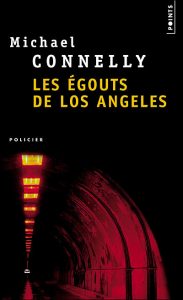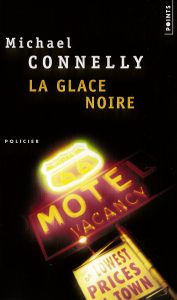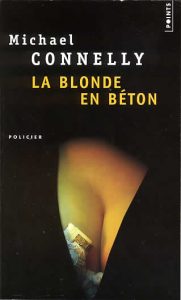Publié en 1973 sous le titre original « Nippon Chinbotsu », « La Submersion du Japon » constitue l’œuvre majeure de Sakyo Komatsu et l’un des piliers de la science-fiction japonaise. Ce roman explore une hypothèse géologique terrifiante : la disparition totale de l’archipel japonais sous les eaux du Pacifique en moins d’un an.
Sakyo Komatsu, architecte de la science-fiction japonaise
Né en 1931 à Osaka et décédé en 2011, Sakyo Komatsu a façonné le paysage de la science-fiction japonaise pendant près de cinquante ans. Après des études en arts et lettres à l’université de Kyoto, il débute sa carrière comme scénariste pour la radio et la télévision avant de se consacrer à l’écriture romanesque.
Son parcours littéraire débute dans les années 1960, période de reconstruction économique accélérée du Japon. Komatsu puise son inspiration dans la science-fiction américaine de l’âge d’or, tout en l’adaptant aux préoccupations spécifiquement japonaises. Sa connaissance des catastrophes naturelles qui jalonnent l’histoire de l’archipel nourrit son imaginaire.
L’auteur a reçu plusieurs distinctions majeures, dont le prix Seiun (équivalent japonais du prix Hugo) et le prix Mystery Writers of Japan. Son influence dépasse largement le cercle des amateurs de science-fiction : il a contribué à légitimer le genre dans la culture japonaise et à en faire un outil de réflexion sur l’identité nationale.
Une prémisse géologique documentée
Le roman s’ouvre sur la disparition soudaine d’une île au large du Japon. Un géophysicien, le professeur Tadokoro, étudie ce phénomène inquiétant. Ses recherches le conduisent à une conclusion glaçante : l’ensemble de l’archipel japonais s’enfoncera dans l’océan Pacifique dans un délai de dix mois, conséquence d’un mouvement tectonique d’une ampleur sans précédent.
Cette hypothèse s’appuie sur des données géologiques réelles. Le Japon se situe à la jonction de quatre plaques tectoniques (Pacifique, Philippines, Eurasie et Amérique du Nord), ce qui explique la fréquence élevée des séismes dans la région. La ceinture de feu du Pacifique, zone d’intense activité volcanique et sismique, traverse l’archipel de part en part.
Komatsu ne se contente pas d’un catastrophisme spectaculaire. Il développe une réflexion scientifique cohérente sur les mécanismes géologiques qui pourraient conduire à un tel cataclysme. Les plaques tectoniques, le magma sous-marin, les failles sismiques constituent le vocabulaire technique d’un récit qui emprunte autant au thriller qu’au documentaire scientifique.
Évacuer cent dix millions de personnes
Face à cette menace existentielle, le gouvernement japonais doit résoudre une équation impossible : comment évacuer cent dix millions d’habitants d’un territoire condamné ? Cette question logistique vertigineuse structure l’ensemble du roman.
Le récit explore les multiples dimensions de cette crise. Sur le plan diplomatique, le Japon doit négocier avec les nations étrangères pour accueillir sa population. Ces tractations révèlent les rapports de force internationaux, les réticences des pays sollicités, les calculs politiques qui président aux décisions humanitaires.
Sur le plan social, la perspective de la diaspora soulève des questions identitaires profondes. Que signifie être Japonais quand le territoire physique du Japon disparaît ? Comment maintenir une culture, une langue, des traditions dans l’exil forcé ? Komatsu examine ces interrogations avec une lucidité remarquable.
La dimension technique occupe également une place centrale. Le roman détaille les opérations de sauvetage : quelles infrastructures évacuer en priorité, comment organiser les départs massifs, quels biens culturels emporter comme témoignage d’une civilisation sur le point de disparaître.
Une réflexion sur l’identité nationale
« La Submersion du Japon » fonctionne comme une méditation philosophique sur ce qui constitue une nation. Komatsu pose une question fondamentale : une nation peut-elle survivre à la perte de son territoire ? L’identité japonaise réside-t-elle dans la géographie de l’archipel ou dans la culture portée par son peuple ?
Cette interrogation résonne avec l’histoire japonaise du XXe siècle. Le Japon de 1973 sort d’une période de reconstruction économique intense après la défaite de 1945. Le miracle économique japonais a transformé un pays détruit en puissance industrielle. La question de l’identité nationale traverse cette période de mutations rapides.
Le roman examine également les structures sociales japonaises face à la catastrophe. La hiérarchie traditionnelle, le sens du devoir collectif, la capacité à supporter les épreuves dans la dignité : autant de traits culturels que Komatsu observe avec un regard à la fois impliqué et distant.
Un ton détaché face à l’apocalypse
L’un des aspects les plus frappants du roman réside dans le ton adopté par l’auteur. Komatsu raconte la disparition de son pays natal avec un flegme et une retenue qui tranchent avec le catastrophisme habituel du genre. Cette distance émotionnelle ne traduit pas une indifférence, mais une forme de stoïcisme profondément japonais.
Cette approche narrative évoque la tradition esthétique du « mono no aware », cette sensibilité à l’éphémère des choses qui traverse la culture japonaise. Face à l’inéluctable, les personnages ne sombrent pas dans le pathos. Ils agissent avec méthode, analysent rationnellement la situation, acceptent ce qui ne peut être changé.
Ce détachement contraste avec les débats souvent passionnés qui traversent d’autres sociétés confrontées à des crises majeures. Komatsu suggère que cette capacité à maintenir la mesure face au désastre constitue peut-être l’essence même de l’identité japonaise qu’il explore.
Un contexte marqué par les catastrophes naturelles
Le roman s’inscrit dans une longue tradition de confrontation aux catastrophes naturelles. Le Japon connaît régulièrement des tremblements de terre dévastateurs, comme le grand séisme du Kanto en 1923 qui détruisit Tokyo et fit plus de cent mille victimes. Les typhons, tsunamis et éruptions volcaniques jalonnent l’histoire de l’archipel.
Cette familiarité avec le désastre a forgé une culture de la préparation et de la résilience. Les Japonais construisent leurs villes en tenant compte du risque sismique, développent des technologies antisismiques, organisent régulièrement des exercices d’évacuation. Komatsu s’appuie sur cette réalité pour construire son récit.
La dimension prémonitoire du roman apparaît rétrospectivement avec le tsunami de 2011 qui ravagea la côte nord-est de Honshu et provoqua la catastrophe nucléaire de Fukushima. Les images de cette catastrophe ont rappelé les scénarios imaginés par Komatsu près de quarante ans plus tôt.
Un phénomène culturel majeur
« La Submersion du Japon » rencontre un succès immédiat lors de sa publication en 1973. Le roman se vend à plusieurs millions d’exemplaires au Japon, un chiffre considérable qui témoigne de sa résonance dans la société japonaise de l’époque.
Ce succès dépasse rapidement le cadre littéraire. Dès 1973, le roman est adapté au cinéma par Shiro Moritani. Ce film devient l’un des plus gros succès commerciaux du cinéma japonais des années 1970. Une nouvelle adaptation cinématographique voit le jour en 2006, réalisée par Shinji Higuchi.
Le roman inspire également une série télévisée, plusieurs adaptations en manga et, en 2020, une série animée produite par Netflix intitulée « Japan Sinks: 2020 ». Cette multiplicité des adaptations témoigne de la pérennité de l’œuvre et de sa capacité à toucher différentes générations et différents médias.
Les autres œuvres de Sakyo Komatsu
Au-delà de « La Submersion du Japon », Komatsu a construit une œuvre variée explorant différentes facettes de la science-fiction. « Sayonara Jupiter » imagine la colonisation des lunes de Jupiter et les tensions géopolitiques qui en découlent. « Virus » explore les conséquences d’une pandémie mondiale, thème qui résonne avec une actualité récente.
Ses nouvelles abordent des thématiques diversifiées : le contact avec des civilisations extraterrestres, les implications philosophiques du progrès technologique, les mutations sociales engendrées par les avancées scientifiques. Cette diversité thématique fait de Komatsu un auteur complet, capable d’explorer tous les registres de la science-fiction.
Un roman fondateur
« La Submersion du Japon » occupe une place particulière dans l’histoire de la science-fiction japonaise. Le roman a légitimé le genre auprès d’un large public et démontré que la science-fiction pouvait porter une réflexion profonde sur l’identité nationale et les enjeux contemporains.
L’œuvre de Komatsu a ouvert la voie à d’autres auteurs japonais de science-fiction et contribué à l’émergence d’une tradition spécifiquement nippone du genre, distincte des modèles américains ou européens. Cette école japonaise se caractérise par son ancrage dans les préoccupations locales et sa capacité à mêler réflexion philosophique et rigueur scientifique.
Une lecture qui résonne aujourd’hui
Plus de cinquante ans après sa publication, « La Submersion du Japon » conserve sa pertinence. Les questions qu’il soulève sur les migrations climatiques, la préservation des cultures menacées, la coopération internationale face aux catastrophes trouvent un écho dans les débats contemporains sur le réchauffement climatique et ses conséquences.
Le roman offre une réflexion mature sur ce qui constitue l’essence d’une nation au-delà de son territoire. Cette interrogation concerne toutes les sociétés confrontées à des bouleversements qui remettent en cause leur existence même. La lecture de Komatsu permet de penser ces enjeux avec la distance et la mesure que l’auteur japonais oppose au chaos.
Un court extrait du livre
Comme d’habitude, la gare centrale de Tokyo était bondée. Sa climatisation ne suffisait pas à atténuer la chaleur et les groupes de jeunes qui partaient vers la mer ou la montagne offraient aux regards des visages souillés, tout comme ceux des gens qui se hâtaient en
Titre dans la langue originale : Nihon Chinbotsu
ce jour de la fête des morts pour aller assister aux cérémonies dans leur province d’origine. Tout en essuyant d’un revers de main la sueur de son menton, Onodera regardait alentour en grimaçant.
Il avait fait si froid à la saison des pluies qu’on se serait cru en mars mais, aussitôt après, une chaleur intense apparut soudain et, ces jours derniers, on avait invariablement plus de 35°C. Des gens tombaient malades à Tokyo et à Osaka, et même certains succombaient. A cette chaleur extraordinaire s’ajoutait l’habituelle pénurie d’eau jamais résolue. Il disposait encore de sept à huit minutes jusqu’à l’arrivée de son train. Le troquet où l’on servait du thé ne l’attirait pas. Il marcha sans but, se frayant un passage dans la foule. Tous ces corps lui semblaient de véritables chaufferettes ! Les travailleurs en manches courtes, les paysannes d’âge mur, massives, charriant d’énormes bagages, des adolescentes, forte en poitrine et en postérieur, toutes entassées, portant des pantalons corsaires ou des bermudas et des rubans de couleurs vives dans leurs cheveux.
Traduction : M. et Mme Shibata Masumi