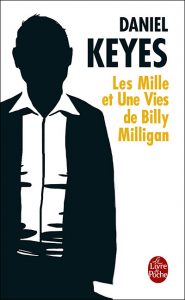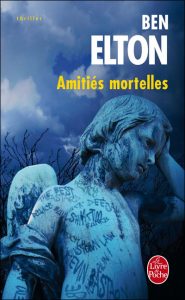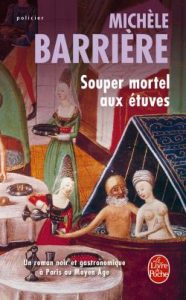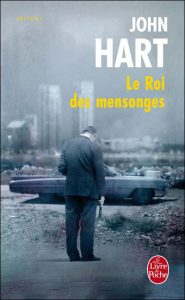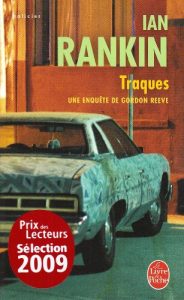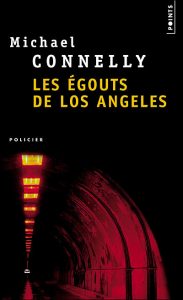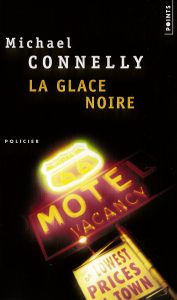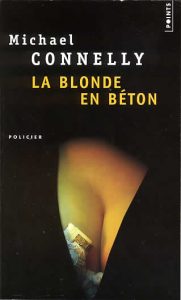Publié le 31 janvier 2008 aux éditions Gallimard, « Un léopard sur le garrot » porte en sous-titre « Chroniques d’un médecin nomade ». Jean-Christophe Rufin y retrace son parcours atypique, de la médecine hospitalière à l’humanitaire, de l’écriture à la diplomatie. Ce récit autobiographique éclaire le fil conducteur d’une existence apparemment dispersée : la fidélité à une vision humaniste de la médecine.
Un titre emprunté à Senghor
Le titre du livre provient d’un vers du poème « Ethiopiques » de Léopold Sédar Senghor : « J’errais, cavale du Zambèze, courant et ruant aux étoiles / Rongée d’un mal sans nom, / Comme d’un léopard sur le garrot. » Cette image du cheval saisi au garrot par un léopard symbolise une existence menée au galop, une course perpétuelle animée par une passion dévorante.
Rufin se reconnaît dans cette métaphore. Sa vie professionnelle témoigne d’une agitation constante, d’une incapacité à se fixer dans une seule activité. Médecin, humanitaire, écrivain, diplomate, académicien : ces multiples casquettes composent un parcours qui pourrait sembler erratique mais révèle en réalité une cohérence profonde.
Jean-Christophe Rufin, itinéraire d’un touche-à-tout
Né le 28 juin 1952 à Bourges dans le Cher, Jean-Christophe Rufin grandit dans une famille marquée par la médecine et la résistance. Son grand-père, médecin de campagne, soigne les combattants durant la Première Guerre mondiale. Résistant pendant la Seconde, il est déporté deux ans à Buchenwald pour avoir caché des résistants. Cette figure tutélaire façonne la vocation médicale du jeune Jean-Christophe.
Après des études secondaires aux lycées Janson-de-Sailly et Claude-Bernard à Paris, Rufin entre simultanément à la faculté de médecine de La Pitié-Salpêtrière et à Sciences Po, dont il sort diplômé en 1979. En 1975, il réussit le concours d’internat à Paris et choisit la neurologie comme spécialité. Il travaille notamment à l’hôpital Rothschild, en salle commune, au contact direct de la misère sociale.
La désillusion hospitalière
Le récit s’ouvre sur l’expérience hospitalière et les désillusions qu’elle engendre. Rufin rêvait de suivre les traces de son grand-père, ce médecin de campagne qui connaissait ses patients, leurs familles, leurs histoires. Il découvre une médecine technique, spécialisée, déshumanisée.
L’hôpital moderne transforme les malades en dossiers, en cas cliniques, en organes défaillants. La hiérarchie médicale rigide, les gardes épuisantes, la bureaucratie administrative éloignent progressivement le soignant du patient. Rufin ressent un malaise croissant face à cette médecine qui soigne les corps mais oublie les personnes.
Il évoque avec humour les comportements déviants du corps médical, cette façon de côtoyer quotidiennement la mort qui pousse à des exutoires parfois morbides. L’anecdote du vol de la tête de Ravachol, conservée dans du formol à l’École de médecine de Paris, illustre cet humour noir nécessaire à la survie psychologique. Rufin et un ami dérobent cette relique macabre pour impressionner une fille, créant involontairement un scandale médiatique lorsque France-Soir présente le vol comme la manifestation d’un renouveau anarchiste. Les deux complices déposent finalement la tête au pied du Panthéon.
L’ouverture humanitaire
Le service militaire constitue le tournant décisif. Rufin part en coopération en Tunisie. Cette expérience lui révèle une double vérité. D’abord, que les maladies sont universelles, identiques sous toutes les latitudes, mais que ce sont les humains qui diffèrent. Ensuite, que la pratique médicale ne peut s’abstraire du contexte politique et social.
De retour en France, il rejoint Médecins sans Frontières à ses débuts. Le livre décrit les premières heures de cette organisation qui révolutionnera l’aide humanitaire. Rufin témoigne des débats internes, des tensions idéologiques, des luttes de pouvoir qui aboutiront à l’éviction de Bernard Kouchner, pourtant cofondateur de l’association.
Ces tensions illustrent les questions fondamentales qui traversent l’humanitaire : jusqu’où peut-on témoigner publiquement ? Comment concilier action sur le terrain et dénonciation des violations des droits humains ? Faut-il privilégier l’efficacité immédiate ou le positionnement éthique ?
Action contre la Faim, une approche différente
Après l’expérience MSF, Rufin rejoint Action contre la Faim. Cette seconde expérience humanitaire se révèle plus structurée, plus professionnelle. Les campagnes d’aide aux populations bénéficient d’une préparation logistique poussée, d’une anticipation des besoins, d’une coordination rigoureuse.
Mais cette professionnalisation soulève d’autres interrogations. Pour agir efficacement dans des zones de conflit ou sous des régimes autoritaires, les organisations humanitaires doivent souvent négocier avec des pouvoirs peu recommandables. Ces compromis nécessaires posent la question de la compromission : comment garder un engagement humaniste pur tout en acceptant de dialoguer avec des régimes injustes ?
Rufin devient président d’Action contre la Faim de 2002 à 2006. Cette fonction lui permet de réfléchir aux enjeux stratégiques de l’aide internationale, aux rapports entre humanitaire et politique, à l’évolution des crises et des réponses apportées.
La naissance de l’écrivain
Parallèlement à ses engagements médicaux et humanitaires, Rufin développe une activité d’écriture. Il publie d’abord des essais consacrés aux questions internationales : « Le Piège humanitaire » (1986), « L’Empire et les nouveaux barbares » (1992), « La Dictature libérale » (1994), qui reçoit le prix Jean-Jacques Rousseau.
Son premier roman, « L’Abyssin », paraît en 1997 et reçoit le prix Goncourt du premier roman ainsi que le prix Méditerranée. Ce succès marque le début d’une carrière romanesque qui ne se démentira pas. En 2001, « Rouge Brésil » lui vaut le prix Goncourt, consécration suprême de la littérature française.
Rufin explore ensuite différents registres littéraires. « Sept histoires qui reviennent de loin » (2011), recueil de nouvelles, témoigne de sa capacité à manier la forme courte. « Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi » (2013), récit autobiographique de son pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, reçoit le prix Pierre Loti et connaît un large succès public.
Le livre « Un léopard sur le garrot » consacre plusieurs passages à la naissance de l’écrivain, à ce moment où l’écriture cesse d’être un à-côté pour devenir une part essentielle de l’identité. Rufin explore les sources de son inspiration : les lieux parcourus, les rencontres, les images marquantes. Il développe une réflexion sur le rôle du romancier et sa complémentarité avec le regard du médecin.
La carrière diplomatique
En 2007, Bernard Kouchner, devenu ministre des Affaires étrangères, nomme Rufin ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Cette nomination s’inscrit dans la tradition des écrivains-diplomates, de Claudel à Morand.
Rufin aborde cette fonction avec le même engagement que ses activités précédentes. Il s’investit dans les relations franco-sénégalaises, participe même avec les agents de la DGSE à la traque de fuyards d’Al-Qaïda après l’assassinat de touristes français en Mauritanie au premier semestre 2008.
Cette dimension diplomatique du parcours témoigne d’une capacité à naviguer entre différents univers, à mobiliser des compétences variées au service d’une même vision : celle d’un engagement au service des autres, qu’il s’agisse de soigner, de témoigner, d’écrire ou de représenter son pays.
L’élection à l’Académie française
Le 19 juin 2008, quelques mois après la publication du livre, Jean-Christophe Rufin est élu à l’Académie française au fauteuil d’Henri Troyat. Il obtient 14 voix contre 12 à l’écrivain Olivier Germain-Thomas. À 56 ans, il devient le plus jeune membre de l’institution.
Cette élection couronne un parcours littéraire qui compte alors une dizaine de romans traduits dans le monde entier. Elle consacre également une œuvre qui n’a cessé d’explorer la rencontre des civilisations et les rapports entre monde développé et pays du Sud.
Il est reçu sous la Coupole le 12 novembre 2009 par Yves Pouliquen. Son épée d’académicien, conçue par l’artiste sénégalais Ousmane Sow et réalisée dans les ateliers de la maison Arthus Bertrand, représente Colombe, personnage emblématique de « Rouge Brésil ».
L’unité d’un parcours éclaté
Le livre révèle que sous l’apparente dispersion des activités se dessine une cohérence profonde. Le fil conducteur qui relie toutes ces expériences est la fidélité à une vision humaniste de la médecine, conçue moins comme une science que comme un engagement auprès des êtres humains.
Rufin cherche constamment à retrouver cette médecine humaine qu’incarnait son grand-père, ce rapport direct aux personnes que la modernité technique a fait disparaître. L’humanitaire lui offre cette possibilité de soigner en tenant compte du contexte social et politique. L’écriture lui permet d’explorer les dimensions humaines que la pratique médicale stricto sensu ne peut embrasser.
Cette unité explique les détours apparents du parcours. Chaque changement d’orientation correspond en réalité à une tentative de trouver un cadre permettant de concilier compétence technique et engagement humaniste.
Une réflexion sur la médecine contemporaine
Au-delà du récit biographique, le livre développe une réflexion critique sur l’évolution de la médecine. Rufin décrit avec précision le passage d’une médecine de l’écoute à une médecine technique. Il dénonce « la redoutable secte des urgentistes » qui commence son règne, cette médecine de l’efficacité immédiate qui évacue la relation soignant-soigné.
Cette critique ne relève pas de la nostalgie passéiste. Rufin reconnaît les progrès techniques considérables de la médecine moderne. Mais il questionne le prix humain de cette évolution : la perte du colloque singulier entre médecin et patient, la réduction de la personne à un corps malade, la disparition du temps nécessaire à l’écoute.
Ces réflexions résonnent avec les débats contemporains sur la crise de l’hôpital public, l’épuisement des soignants, la déshumanisation du système de santé. Rufin témoigne de l’intérieur de processus qu’il a vus s’installer progressivement.
Les zones d’ombre volontaires
Le récit reste discret sur la vie privée de l’auteur. Rufin évoque peu sa vie sentimentale, ses relations familiales, ses doutes intimes. Ce choix délibéré concentre le propos sur le parcours professionnel et intellectuel.
Cette pudeur peut frustrer certains lecteurs en quête d’intimité. Elle correspond cependant à une conception de l’autobiographie centrée sur la construction d’une vocation et l’évolution d’une pensée plutôt que sur l’exhibition de la sphère privée.
Le livre contient également quelques imprécisions chronologiques qui peuvent dérouter. Les allers-retours temporels, les ellipses, les digressions créent parfois une confusion dans la succession des événements. Cette construction non linéaire reflète peut-être le caractère mouvementé du parcours raconté.
Un style au service du récit
Rufin mobilise dans ce livre autobiographique le talent narratif qui fait le succès de ses romans. L’écriture reste fluide, accessible, sans jargon technique inutile. L’auteur sait rendre vivantes des situations complexes, donner de la chair à des débats abstraits.
Cette qualité d’écriture explique le succès du livre auprès d’un large public. « Un léopard sur le garrot » se lit comme un roman d’aventures où le héros serait l’auteur lui-même. Les anecdotes ponctuent le récit, les portraits de personnages rencontrés enrichissent le tableau, les descriptions de lieux parcourus transportent le lecteur.
Une source d’inspiration
Au-delà de son intérêt biographique, le livre offre matière à réflexion sur des questions qui dépassent le seul parcours de Rufin. Comment concilier idéal et réalité dans l’exercice d’une profession ? Comment rester fidèle à ses valeurs tout en acceptant les compromis nécessaires à l’action ? Comment construire une cohérence de vie dans un monde qui pousse à la spécialisation ?
Ces interrogations traversent le livre et donnent au récit une portée universelle. Les choix que Rufin a dû faire, les dilemmes qu’il a affrontés, les désillusions qu’il a connues parlent à tous ceux qui tentent de donner du sens à leur parcours professionnel.
Le livre inspire par son refus de la facilité, par sa volonté de ne jamais s’installer dans une position confortable, par sa quête perpétuelle d’un engagement authentique. Il montre qu’une vie peut être à la fois dispersée en apparence et profondément cohérente, que la multiplicité des expériences enrichit plutôt qu’elle ne dilue.
« Un léopard sur le garrot » constitue ainsi un témoignage précieux sur une époque, sur l’évolution de la médecine et de l’humanitaire, mais aussi sur la possibilité de mener une vie guidée par des convictions humanistes sans renoncer à l’efficacité ni à l’excellence.
Un court extrait du livre
Les critères qui, en France tout au moins, décident de la mort sont assez flous. Ils datent de l’époque où le signe le plus certain du trépas était l’arrêt durable de la circulation du sang, arrêt que la médecine a appris depuis lors à combattre. Les manœuvres légales pour décider de la mort consistent théoriquement en divers charcutages des veines du bras, destinées à montrer que le sang ne s’y écoule plus. Elles sont si compliquées et si douteuses que personne ne les pratique jamais. La mort est attestée par un autre moyen, à la fois plus empirique et plus certain, que l’on appelle l’expérience. Un mort est mort, voilà tout. N’importe quelle infirmière avec un minimum de pratique peut acquérir cette certitude. Pourtant, une telle conviction, même confirmée par l’évidence, n’a pas force de loi. En dernier ressort, c’est au médecin et à lui seul de déclarer la mort, privilège qui ressemble à celui des chefs d’État de déclarer la guerre.
Si inexpérimenté soit-il, l’interne, en particulier la nuit, est celui qui sur un appel des équipes soignantes, prend la responsabilité de faire passer le malade du monde corruptible des vivants à la paix éternelle des morts.
Chaque nuit de garde, nous étions appelés ainsi, pour signer, selon la formule consacrée, des « billets de salle ». Cette feuille administrative témoigne de l’entrée du patient à l’hôpital. Il importe ensuite d’y faire figurer le moyen qu’il a utilisé pour en sortir. Ce peut être au terme de son traitement, un avis favorable des médecins ; ce peut être, sous sa responsabilité, l’évasion ou la rébellion. La sortie peut être provisoire – « une permission » – ou définitive. Le plus radical de ces élargissements s’appelle la mort.
Quelquefois, les nuits d’hiver, recru de fatigue, certains d’entre nous – je l’ai fait moi-même – cédaient à la tentation de signer sans se déplacer le certificat de décès d’un patient. Un garçon de salle tendait le papier sous la porte de notre chambre et, les paupières gonflées, la voix pâteuse, nous nous contentions de lui demander : « il est bien mort, hein ?… Pas de blague ! » à partir d’un certain degré de fatigue, un grognement suffisait à nous rassurer.