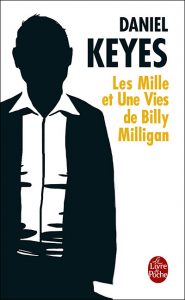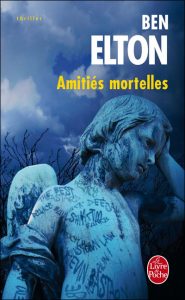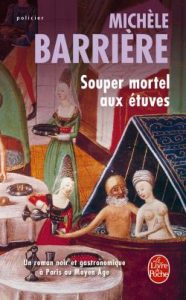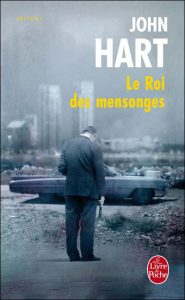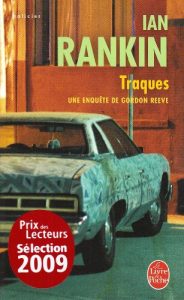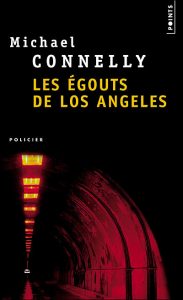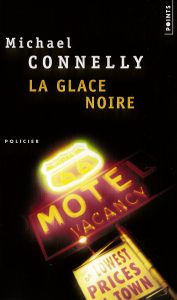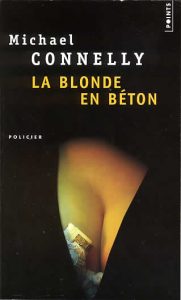Paru le 17 août 2011 aux éditions Jean-Claude Lattès, « Rien ne s’oppose à la nuit » marque un tournant dans l’œuvre de Delphine de Vigan. Après le suicide de sa mère en 2008, l’auteure entreprend un travail de mémoire qui dépasse le simple récit autobiographique pour interroger la transmission, les secrets familiaux et le pouvoir destructeur du silence.
Delphine de Vigan, du sondage à la littérature
Née le 1er mars 1966 à Boulogne-Billancourt, Delphine de Vigan connaît un parcours scolaire précoce qui la mène au lycée Fénelon pour une préparation au concours de Normale Sup. Cette période est marquée par une hospitalisation de six mois pour anorexie, expérience qu’elle racontera dans son premier roman « Jours sans faim » (2001), publié sous le pseudonyme Lou Delvig.
Après des études au CELSA et divers emplois, elle devient directrice d’études dans un institut de sondages. Elle écrit le soir, sans prétendre à la carrière littéraire qui sera la sienne. Le succès de « No et moi » en 2007, couronné par le prix des libraires en 2008, lui permet enfin de vivre de sa plume. Adaptée au cinéma par Zabou Breitman en 2010, cette histoire d’une adolescente surdouée qui vient en aide à une jeune SDF touche un large public.
« Les Heures souterraines » (2009), qui dénonce le harcèlement moral dans le monde du travail, la consacre comme une voix importante de la littérature contemporaine. Le roman est nommé au prix Goncourt et reçoit plusieurs distinctions.
Une enquête familiale après le deuil
« Rien ne s’oppose à la nuit » naît d’un deuil. En 2008, Lucile, la mère de Delphine de Vigan, se suicide. Cette disparition déclenche chez l’auteure le besoin de comprendre, de reconstituer la vie de cette femme atteinte de troubles bipolaires qui a marqué son enfance et son adolescence.
Delphine de Vigan mène alors une véritable enquête. Elle convoque les oncles, les tantes, les cousins, tous les témoins que compte la famille. Elle interroge, écoute, enregistre. Elle rassemble des lettres, des photographies, des documents. Cette documentation massive constitue la matière première d’un récit qui oscille entre le roman et le témoignage.
Le livre alterne deux types de chapitres. D’un côté, le récit de la vie de Lucile : son enfance, son adolescence, sa vie de femme et de mère. De l’autre, la description du processus d’écriture lui-même, avec ses doutes, ses angoisses, ses impasses. Cette structure réflexive fait du livre un objet littéraire singulier qui contient « sa propre genèse, ses errances narratives, ses tentatives inachevées ».
Lucile, portrait d’une femme fracturée
Lucile apparaît dans le récit comme une femme belle et énigmatique, mannequin pour des campagnes publicitaires, mère de deux filles. Mais cette apparence cache une réalité bien plus sombre. Atteinte de troubles bipolaires, elle connaît des épisodes psychotiques qui la conduisent à des hospitalisations répétées.
L’enfance de Lucile est marquée par des drames familiaux successifs. Delphine de Vigan remonte le fil de cette histoire pour tenter de comprendre les origines de la souffrance maternelle. Elle découvre une famille nombreuse, charismatique, haute en couleurs, mais rongée par des secrets et des non-dits.
La bipolarité de Lucile se manifeste par des alternances entre périodes d’exubérance et phases de retrait total. Delphine adolescente rentre un jour du collège et voit à travers la fenêtre éclairée sa mère nue, peinte en blanc. Ce moment fondateur marque le début de la prise de conscience de la folie maternelle et du danger qu’elle représente pour les enfants.
La famille comme théâtre du chaos
Le livre dresse le portrait d’une famille fascinante qui « incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l’écho inlassable des morts, et le retentissement du désastre ». Cette tribu nombreuse oscille entre moments de bonheur intense et drames à répétition.
Delphine de Vigan révèle progressivement les failles de ce système familial. Les tantes cyclothymiques, les suicides, les hommes incestueux : la litanie des malheurs compose une fresque où le tragique côtoie sans cesse l’ordinaire. L’auteure montre comment les silences et les secrets empoisonnent les relations et se transmettent de génération en génération.
Le livre illustre « le pouvoir de destruction du verbe, et celui du silence ». Les mots qui blessent, les choses qu’on ne dit pas, les vérités qu’on enfouit : autant de forces qui rongent les individus et les liens familiaux.
L’équilibre entre distance et émotion
L’un des réussites du livre tient à son équilibre tonal. Delphine de Vigan évite le double écueil qui menace ce type de récit : la sécheresse clinique d’un côté, le pathos larmoyant de l’autre. L’écriture reste sobre, précise, presque factuelle par moments, tout en laissant affleurer l’émotion.
L’auteure maintient une forme de distance avec son sujet, se positionnant davantage en enquêtrice qu’en fille éplorée. Cette posture permet au lecteur de construire son propre rapport au récit sans être manipulé par des effets de style destinés à arracher des larmes.
Cette retenue n’empêche pas les moments d’émotion forte. Le livre convoque une palette de sentiments variés : la tristesse bien sûr, mais aussi la colère, la tendresse, l’incompréhension, et même l’humour. Car Lucile savait être drôle, et sa fille restitue cette dimension sans la noyer dans le tragique.
La question de la légitimité
Delphine de Vigan interroge explicitement la légitimité de son geste. Avait-elle le droit d’écrire sur sa mère ? De livrer au public les secrets de sa famille ? D’exposer les failles et les blessures de ceux qui l’ont précédée ? Ces questions traversent le livre et lui donnent une dimension éthique qui dépasse le simple témoignage.
L’auteure assume pleinement la subjectivité de son récit. Elle ne prétend pas dire la vérité sur Lucile, mais sa vérité, construite à partir de fragments, de témoignages contradictoires, de souvenirs incertains. Cette humilité narrative renforce la crédibilité du propos.
Un succès critique et public
Le livre reçoit un accueil considérable. Il figure dans les sélections des prix Goncourt, Médicis et Renaudot. Il obtient le prix du roman Fnac 2011, le prix Roman France Télévisions 2011, le prix Renaudot des lycéens 2011 et le Grand Prix des lectrices de Elle 2012.
Ces distinctions témoignent de la capacité du livre à toucher un large public. « Rien ne s’oppose à la nuit » parle à beaucoup de lecteurs parce qu’il aborde des questions universelles : les relations parents-enfants, la transmission des traumatismes, le poids des secrets familiaux, la maladie mentale.
Le livre fonctionne aussi comme un exorcisme. En écrivant sur Lucile, Delphine de Vigan tente de se libérer du poids de l’héritage maternel, de comprendre comment elle a été constituée par cette douleur sans en être prisonnière. L’écriture devient un outil de reconstruction personnelle autant qu’un hommage filial.
« Rien ne s’oppose à la nuit » s’inscrit dans une tradition littéraire d’interrogation sur les liens familiaux et la transmission. Le livre dialogue avec d’autres œuvres qui ont exploré ces thématiques, d’Annie Ernaux à Pierre Michon.
Delphine de Vigan apporte sa contribution personnelle à cette réflexion en intégrant la dimension métanarrative. Le livre ne raconte pas seulement l’histoire de Lucile, il raconte aussi comment on raconte cette histoire. Cette mise en abyme enrichit le propos et fait du livre un objet littéraire conscient de ses propres procédés.
Une lecture qui interpelle
« Rien ne s’oppose à la nuit » ne laisse pas indifférent. Le livre interpelle par la violence des situations qu’il décrit, par la complexité des relations familiales qu’il dévoile, par les questions éthiques qu’il soulève. Il oblige le lecteur à s’interroger sur sa propre histoire familiale, sur les secrets qu’elle recèle, sur les silences qui la structurent.
Cette capacité à faire résonner l’expérience personnelle avec l’universel constitue la force du livre. En racontant Lucile, Delphine de Vigan raconte quelque chose de nos familles, de nos failles, de nos propres blessures. Elle transforme le singulier en général sans jamais perdre la singularité de son propos.
Le livre mérite sa place parmi les œuvres importantes de la littérature française contemporaine, non pour sa perfection formelle mais pour sa justesse émotionnelle et son honnêteté. Delphine de Vigan a su trouver les mots pour dire l’indicible et donner forme à ce qui échappait au langage.
Reste le titre qui me démange un peu… pourvu que le procédé commode et facile d’utiliser le titre d’une chanson ne fasse pas d’émules !
Un court extrait du livre
Je n’ai pas écrit comment, après mon retour à Paris et le séjour de Lucile à Sainte-Anne, le temps d’une année scolaire, j’avais cessé de m’alimenter, jusqu’à sentir la mort dans mon corps. C’est d’ailleurs précisément ce que je voulais : sentir la mort dans mon corps. À dix-neuf ans, alors que je pesais trente-six kilos pour un mètre soixante-quinze, j’ai été admise à l’hôpital dans un état de dénutrition proche du coma.
Rien ne s’oppose à la nuit, de Delphine le Vigan
En 2001, j’ai publié un roman qui raconte l’hospitalisation d’une jeune femme anorexique. Le froid qui l’envahit, la renutrition par sonde entérale, la rencontre avec d’autres patients, le retour progressif des sensations, des sentiments, la guérison. Jours sans faim est un roman en partie autobiographique, pour lequel je souhaitais maintenir, à l’exception de quelques incursions dans le passé, une unité de temps, de lieu et d’action. La construction l’a emporté sur le reste, aucun des personnages secondaires n’a vraiment existé, le roman comporte une part de fiction et j’espère, de poésie.
Ma démarche actuelle me semble à la fois plus périlleuse et plus vaine. Aujourd’hui, il arrive toujours un moment où les outils me tombent des mains, où la reconstruction m’échappe, parce que je cherche une vérité qui se situe au-delà de moi, qui est hors de ma portée.
L’anorexie ne se résume pas à la volonté qu’ont certaines jeunes filles de ressembler aux mannequins, de plus en plus maigres il est vrai, qui envahissent les pages des magazines féminins. Le jeûne est une drogue puissante et peu onéreuse, on oublie souvent de le dire. L’état de dénutrition anesthésie la douleur, les émotions, les sentiments, et fonctionne, dans un premier temps, comme une protection. L’anorexie restrictive est une addiction qui fait croire au contrôle alors qu’elle conduit le corps à sa destruction. J’ai eu la chance de rencontrer un médecin qui avait pris conscience de ça, à une époque où la plupart des anorexiques étaient enfermées entre quatre murs dans une pièce vide, avec pour seul horizon un contrat de poids.
Je ne reviendrai pas ici sur cette période de ma vie, seul m’intéresse l’impact qu’elle a pu avoir sur Lucile, son retentissement.
Lucile, plus désarmée que jamais, fut la spectatrice lointaine de mon effondrement. Sans un geste, sans une parole de colère ni de chagrin, sans être capable d’exprimer quoi que ce fût, tout le temps que dura ma chute, Lucile m’a fait face, privée de parole, sans pour autant se détourner. Lucile, dont les mots tardifs, « mais alors tu vas mourir », et le ton d’impuissance sur lequel elle les prononça, me donnèrent à entendre l’impasse dans laquelle je me trouvais.
Quelques années plus tard, lorsque j’ai été mère moi-même, j’ai souvent pensé à la douleur que j’avais infligée à la mienne.