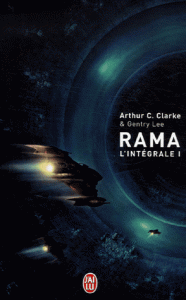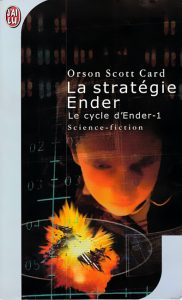Après avoir posé les fondations vertigineuses de son univers dans Le Problème à trois corps, Liu Cixin poursuit sa trilogie avec La Forêt sombre, publié en 2008 en Chine et traduit en français en 2017 chez Actes Sud. Ce deuxième tome explore une question rarement abordée dans la science-fiction d’invasion : que devient une société qui doit vivre quatre siècles dans l’ombre d’une menace certaine mais lointaine ?
Liu Cixin, architecte de la hard science-fiction chinoise
Ingénieur de formation, Liu Cixin a travaillé pendant près de trente ans dans une centrale électrique de la province du Shanxi avant de se consacrer pleinement à l’écriture. Cette trajectoire technique transparaît dans son approche rigoureuse de la science-fiction, où les lois physiques dictent les règles du jeu narratif. Reconnu comme le principal représentant de la science-fiction chinoise contemporaine, il a reçu le prix Hugo en 2015 pour Le Problème à trois corps, une première pour un auteur asiatique. Son œuvre se distingue par une échelle temporelle démesurée et une vision pessimiste des relations interstellaires, héritée de la sociologie cosmique qu’il développe dans sa trilogie.
Quatre cents ans d’attente
La Forêt sombre s’ouvre au lendemain de la révélation finale du premier tome. L’humanité sait désormais que la flotte trisolarienne navigue vers la Terre, mais elle dispose d’un répit de quatre siècles avant son arrivée. Cette temporalité particulière structure tout le roman : comment maintenir une mobilisation face à une menace que personne ne verra de son vivant ? Comment planifier la défense d’une civilisation sur quinze générations ?
Liu Cixin explore ces questions à travers le programme des Porte-Épées, quatre stratèges choisis pour élaborer des plans de défense à long terme. Parmi eux, Luo Ji, un sociologue cynique qui préférerait profiter de sa retraite anticipée plutôt que de porter le poids du destin humain. Le passage que j’ai sélectionné illustre cette tension entre l’individu ordinaire et les enjeux cosmiques.
L’ordinaire face au cosmique
Zhang Yuanchao avait remis la veille le dossier administratif de sa demande de départ à la retraite. Il allait quitter l’usine chimique dans laquelle il avait travaillé plusieurs décennies. Pour citer son voisin – Lao Yang –, ce jour-là marquait le début de sa seconde jeunesse. Lao Yang lui avait raconté que soixante ans, avec seize ans, était le plus bel âge de la vie. À soixante ans, tous les fardeaux que l’on portait sur les épaules à quarante ou cinquante ans étaient derrière nous, et l’indolence et la maladie qui guettaient les septuagénaires et les octogénaires n’étaient pas encore arrivées.
Ce dialogue entre Zhang Yuanchao, ouvrier fraîchement retraité, et son voisin Yang Jinwen, ancien enseignant, résume toute la philosophie du roman. Pendant des années, Zhang s’est désintéressé des affaires du monde, préférant la tranquillité de son quotidien aux débats sur la politique internationale. Yang, au contraire, incarnait le citoyen engagé, convaincu que les grandes décisions géopolitiques finissent toujours par affecter les vies individuelles.
L’ironie du passage réside dans ce retournement : confronté à l’imminence de l’invasion trisolarienne, Yang abandonne son engagement intellectuel, reconnaissant l’impuissance humaine face à l’ampleur du défi. Zhang, lui, découvre tardivement que son voisin avait raison : « l’invasion américaine du Venezuela » ou « la prolifération nucléaire » ne sont rien comparées à une menace qui dépasse toutes les compétences humaines. La catastrophe cosmique rend dérisoires les préoccupations terrestres tout en validant rétrospectivement l’intuition que les grands événements façonnent le quotidien.
La sociologie du désespoir
Liu Cixin excelle dans cette capacité à zoomer du microscopique au macroscopique. Les préoccupations domestiques de Zhang – sa retraite, son fils marié, son appartement obtenu après une démolition – s’inscrivent dans une société chinoise contemporaine reconnaissable. Puis, brutalement, le texte bascule vers l’échelle cosmique. Cette technique narrative rappelle que la science-fiction n’est jamais plus efficace que lorsqu’elle ancre ses spéculations dans le réel palpable.
Le roman développe également la théorie de la forêt sombre, axiome central de la trilogie qui postule que toute civilisation découvrant une autre doit la détruire par précaution. Cette vision darwinienne du cosmos transforme l’univers en un lieu de silence et de méfiance généralisée, où la communication équivaut à un arrêt de mort. L’optimisme des premiers contacts extraterrestres, hérité de Clarke ou Sagan, n’a pas sa place dans l’univers de Liu Cixin.
Une écriture au service de l’idée
Comme dans le premier tome, l’écriture de Liu Cixin reste fonctionnelle, presque documentaire. Les dialogues servent à exposer des concepts plutôt qu’à développer une psychologie fine. Certains lecteurs y verront une faiblesse, d’autres reconnaîtront la tradition de la hard science-fiction où l’idée prime sur le style. Le passage cité illustre cette approche : les personnages sont des vecteurs d’interrogations philosophiques plus que des individualités complexes.
La traduction française de Gwennaël Gaffric restitue cette sobriété tout en préservant les références culturelles chinoises qui ancrent le récit dans son contexte d’origine. Les dialogues entre voisins pékinois, les structures familiales, la relation aux autorités, tout cela donne une texture particulière à un genre souvent occidentalo-centré.
Verdict : l’attente comme condition métaphysique
La Forêt sombre confirme l’ambition démesurée de Liu Cixin. Là où le premier tome posait le problème, ce deuxième volume explore ses conséquences sociologiques et philosophiques. Le roman interroge notre rapport au temps long, à la transmission intergénérationnelle des responsabilités, à la capacité humaine de planifier au-delà de l’horizon individuel. Dans une époque obsédée par l’immédiateté, cette méditation sur l’attente et la durée résonne avec une acuité particulière.
Les lecteurs pressés d’action spatiale seront déçus : le livre privilégie la spéculation intellectuelle aux batailles interstellaires. Mais ceux qui acceptent ce rythme contemplatif découvriront une réflexion vertigineuse sur la place de l’humanité dans un univers hostile. Le troisième tome, La Mort immortelle, attend d’être lu pour clore cette fresque cosmique qui aura profondément renouvelé les codes de la science-fiction contemporaine.
La Forêt sombre de Liu Cixin, traduit du chinois par Gwennaël Gaffric, Actes Sud, 2017, 640 pages.
Un extrait du livre
Zhang Yuanchao avait remis la veille le dossier administratif de sa demande de départ à la retraite. Il allait quitter l’usine chimique dans laquelle il avait travaillé plusieurs décennies. Pour citer son voisin – Lao Yang –, ce jour-là marquait le début de sa seconde jeunesse. Lao Yang lui avait raconté que soixante ans, avec seize ans, était le plus bel âge de la vie. À soixante ans, tous les fardeaux que l’on portait sur les épaules à quarante ou cinquante ans étaient derrière nous, et l’indolence et la maladie qui guettaient les septuagénaires et les octogénaires n’étaient pas encore arrivées. C’était l’âge idéal pour profiter de l’existence. Le fils et la belle-fille de Zhang Yuanchao avaient chacun un boulot stable, et quoique son fils se fût marié assez tard, il savait qu’il ne tarderait pas à serrer une petite-fille ou un petit-fils dans les bras. Ni lui ni son épouse n’auraient normalement pu avoir les moyens de s’offrir la maison qu’ils occupaient aujourd’hui, mais ils avaient été relogés ici après que leur précédent logement avait été rasé. Ils vivaient maintenant dans l’immeuble depuis plus d’un an… Tout bien réfléchi, il ne pouvait se plaindre de rien. Cependant, quand il observait le ciel clair de la ville depuis la fenêtre de son appartement du huitième étage, il ne sentait aucun rayon de soleil lui réchauffer le cœur. Alors pour ce qui était d’une seconde jeunesse… Il devait cependant bien admettre que Lao Yang ne se trompait pas quand il parlait de la situation de la nation.
Liu Cixin – « La forêt sombre »
Son voisin, Yang Jinwen, était enseignant du secondaire à la retraite. Il préconisait souvent à Zhang Yuanchao de s’initier à de nouvelles pratiques s’il voulait profiter de ses vieilles années. « Surfer sur Internet, par exemple. Si même les bébés y arrivent, pourquoi pas toi ? » Il fit remarquer à Zhang Yuanchao que son plus gros défaut était de n’éprouver aucun intérêt pour le monde extérieur. Sa vieille épouse, elle, au moins, séchait ses larmes devant ses séries télévisées à l’eau de rose, mais lui ne regardait même pas la
télévision. Il devait se préoccuper davantage de la situation de la nation et du monde, c’était un élément incontournable d’une vie bien remplie. Bien que Zhang Yuanchao fût un Pékinois pur souche, il n’en avait pas l’air. N’importe quel chauffeur de taxi de la ville pouvait analyser et cancaner pendant des heures sur le cours du pays et du monde, mais lui, s’il connaissait naturellement le nom du président, n’était même pas sûr de pouvoir nommer le Premier ministre. Zhang Yuanchao en tirait néanmoins une certaine fierté, il racontait qu’il était un homme ordinaire, qu’il coulait des jours tranquilles, sans avoir besoin de se soucier d’affaires qu’il ne comprenait pas et qui n’avaient de toute façon aucun impact sur son existence. Grâce à ce recul, disait-il, il s’épargnait bien des tracas. Alors que Lao Yang, qui s’intéressait quant à lui aux affaires du monde, se faisait un point d’honneur de regarder quotidiennement les informations télévisées ; par ailleurs, le sang lui montait à la tête dès qu’il prenait part sur Internet à des débats sur la politique du pays ou sur la prolifération nucléaire dans le monde. Et malgré tout ça – aimait à lui rappeler Zhang Yuanchao –, le gouvernement ne lui versait pas un sou de plus sur sa pension de retraite. Yang Jinwen lui répondait : « Lao Zhang, tu es ridicule. Des affaires incompréhensibles ? Des événements sans impact sur ton existence ? Permets-moi de te dire, mon vieux, que toutes les grandes problématiques du pays et du monde, que n’importe quelle prise de décision politique nationale, n’importe quelle résolution des Nations unies finissent toutes tôt ou tard par influencer ta vie, directement ou indirectement. Tu crois peut-être que l’invasion américaine du Venezuela ne te concerne pas ? Je te le dis, cet événement aura à long terme un impact beaucoup plus important sur ton quotidien qu’une unité de plus sur ta pension de retraite. » Plus d’une fois, Zhang Yuanchao s’était moqué de l’emphase de son ami. Mais il savait désormais que Yang Jinwen avait raison.
Il sonna à la porte de Yang Jinwen. Celui-ci semblait revenir de promenade et avait l’air d’un regard légère. Zhang Yuanchao le dévisagea avec le voyageur solitaire dans le désert qui aurait enfin rencontré un compagnon et refuserait de le laisser partir.
— Je t’ai cherché tout à l’heure, où étais-tu parti ?
— Faire un tour au marché du matin, j’y ai croisé une femme qui achetait des légumes.
— Pourquoi est-ce que tout l’immeuble a l’air si vide. On se croirait dans… un cimetière.
— Ce n’est pas férié aujourd’hui, il ne faut pas te mettre dans un état pareil. Haha, c’est ton premier jour de retraite, c’est normal de te sentir comme ça. Et heureusement, tu n’étais pas patron, ce sont eux qui ont le plus de mal à prendre leur retraite. Tu t’habitueras vite. Viens, si on allait faire un tour au centre de loisirs du quartier.
— Non, non, ce n’est pas à cause de ma retraite, mais à cause de… comment dire, de la situation du pays, ou plutôt non, du monde…
Yang Jinwen éclata de rire en pointant Lao Zhang du doigt :
— La « situation du monde » ? Et ça sort de ta bouche ?
— Oui, oui. Avant je ne me préoccupais pas de tout ça, mais ce qui est maintenant devant nous… c’est trop grave ! Je n’avais jamais rien imaginé qui puisse être aussi grave !
— Lao Zhang, ça me fait drôle de te le dire, mais j’en viens aujourd’hui à penser comme toi. Je ne m’occupe plus de ce que je ne peux pas comprendre. Crois-moi ou non, ça fait déjà quinze jours que je n’ai pas regardé les infos à la télévision. Avant, je me souciais des grands événements, mais c’était parce que les individus pouvaient avoir une carte à jouer, qu’ils pouvaient changer le cours des choses. Mais ça… c’est au-delà de nos compétences. À quoi bon se torturer l’esprit ?